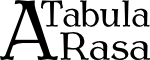Alfredo M. Bonanno
Le projet révolutionnaire
Le projet révolutionnaire
Saisir les différents aspects de l’intervention révolutionnaire n’est pas chose facile. Les saisir dans leur ensemble pour les insérer dans une proposition globale, avec sa propre logique intrinsèque et une articulation opératoire valide, c’est encore plus difficile.
Voilà ce que j’entends par projet révolutionnaire.
L’identification de l’ennemi est une chose suffisamment partagée. À travers une définition vague, on agglomère différents éléments provenant de nos expériences (souffrances et joies), de notre situation sociale, de notre culture. Chacun croit disposer des éléments adéquats pour dresser la carte du territoire adverse et identifier les objectifs et les responsabilités.
Que les choses ne se déroulent pas comme on s’y attendait est tout à fait normal. Qu’importe. Quand l’occasion se présente, prenons en compte les modifications et reprenons la route.
Plongés dans l’obscurité, sans savoir comment procéder, nous continuons, confiants, à aller de l’avant, guidés par la faible lueur de l’idéologie.
Hélas, les choses qui nous entourent changent, et parfois même très rapidement. Les modalités des rapports de classes, qui évoluent sans cesse de façon contradictoire, semblaient s’éclaircir hier pour plonger dans la confusion le lendemain. Ainsi, les certitudes d’hier disparaissent dans le brouillard d’aujourd’hui.
Celui qui garde le cap de façon constante, même si ce cap n’est pas immuable, n’est pas pris pour ce qu’il est en réalité, à savoir un navigateur sincère sur la mer complexe des rapports de classe, mais pour le répétiteur obstiné de schémas dépassés et de métaphores idéologiques et abstraites. Celui qui persiste à voir l’ennemi derrière l’uniforme, l’usine, le ministre, l’école, l’église etc., se voit regardé avec complaisance. A la dure réalité des choses on voudrait substituer un rapport abstrait, une façon d’être, une possible relativité des positions. Et ainsi l’État se transforme en une simple façon de voir le monde et n’est plus un fait concret constitué d’hommes et de choses. Le fait est que l’État ne peut être combattu sans attaquer les hommes et les choses qui le font exister. Attaquer les idées de façon isolée, en comptant l’emporter sur le terrain de la contradiction logique et espérer ainsi modifier leur réalité matérielle, est une illusion idéaliste tragique. C’est dans une époque comme celle-là que nous vivons, une époque de reflux des luttes et des propositions opératoires.
Aucun anarchiste ne prétendrait, à moins de ne plus pouvoir se respecter, que l’État puisse avoir une fonction positive. On en déduit logiquement qu’une fonction non positive, est forcément négative ; elle nuit donc à quelqu’un au bénéfice de quelqu’un d’autre. Mais l’État n’est pas (seulement) l’idée de l’État, c’est aussi « la chose État », et cette « chose » est constituée de policiers et de commissariats, de ministres et de ministères (et aussi des bâtiments où ils se trouvent), de prêtres et d’églises (et donc d’endroits où l’on vénère la tromperie et la mensonge), de banquiers et de banques, de spéculateurs et de leurs bureaux, jusqu’aux indics et à leurs appartements plus ou moins confortables dans des quartiers périphériques. Soit l’État est l’ensemble de toutes ces choses articulées, soit il n’est rien, une vague abstraction, un modèle théorique que l’on ne peut ni attaquer ni détruire.
Évidemment, l’idée de l’État est également ancrée à l’intérieur de nous et des autres. Mais c’est une idée matérialisée, qui s’incarne dans des lieux et des corps physiques. S’attaquer à l’idée que représente l’État (à cette idée que nous portons également en nous, souvent sans même nous en apercevoir), n’est possible qu’en l’attaquant physiquement pour détruire sa matérialisation historique ; à ce qui se tient devant nous, en chair et en os, en briques et en béton.
Mais comment attaquer ? Les choses sont solides. Les hommes se défendent et se retranchent. Le choix des moyens d’attaque est, lui aussi, victime du malentendu que nous venons d’évoquer.
Nous pouvons (et devons) attaquer en nous servant de nos idées, en opposant les critiques, les logiques et les analyses les unes aux autres. Mais cet exercice serait vain s’il n’était réalisé que de façon isolée, séparé d’une intervention directe contre les choses et les hommes de l’État (et du capital, évidemment). Ainsi, on n’attaque pas uniquement avec des idées, mais aussi avec des armes. Je ne vois pas d’autre issue. Se limiter à une course idéologique fournit des éléments à l’ennemi. Il nous faut donc un approfondissement théorique parallèle et simultané à l’attaque pratique.
C’est justement dans l’attaque que la théorie se transforme en pratique et que la pratique assume ses fondements théoriques. En se limitant à la théorie, on reste dans le champ de l’idéalisme, une philosophie typiquement bourgeoise qui a rempli pendant des centaines d’années les coffres-forts de la classe dominante et les camps d’exterminateurs, de droite comme de gauche. Quand bien même cet idéalisme se camouflerait en matérialisme (historique), il s’agirait toujours de ce vieil idéalisme qui détruit les hommes de l’intérieur. Un matérialisme libertaire se doit de dépasser la séparation entre l’idée et le fait. Si on identifie l’ennemi, il faut le frapper, et le frapper de manière adéquate. Cette adéquation ne se juge pas à une destruction optimale du point de vue de l’assaillant ; elle doit correspondre à une évaluation de la situation générale, qui englobe toutes les parties constituant les défenses et les possibilités de survie et de croissance de l’ennemi. Si l’on frappe, il faut le faire de manière à détruire une partie de sa structure et compliquer ainsi le fonctionnement de l’ensemble. Considérées de façon isolée, ces attaques peuvent sembler peu significatives. Leur impact réel est difficile à mesurer. Pour y parvenir, l’attaque doit s’accompagner d’un approfondissement critique des idées de l’ennemi, ces idées qui font partie de son action répressive et oppressive.
Mais cette transformation réciproque de l’action pratique en action théorique, et de théorie en pratique, ne doit pas devenir un simple assemblage artificiel, comme si, après avoir accompli une action, on y accolait une revendication. Ce n’est pas de cette façon que nous approfondirons notre critique des idées adverses. Au contraire, les arguments de l’ennemi s’y cristallisent dans un processus idéologique et apparaissent comme une contradiction massive à ceux de l’attaquant, qui se transforment à leur tour en un bloc idéologique. Je crois qu’il y a peu de choses que je trouve aussi détestables que cette façon de procéder.
Peut on faire autrement ?
C’est dans la transformation de la théorie en pratique, et vice-versa, que se trouve le projet. Le projet, comme ensemble articulé, rend l’action pratique et donne une signification à la critique des idées de l’ennemi. L’élaboration et la réalisation d’un projet représentent l’essentiel du travail d’un révolutionnaire.
Mais, avant de savoir en quoi pourrait consister un projet révolutionnaire, il faut s’accorder sur les choses dont doit disposer un révolutionnaire pour pouvoir en entamer l’élaboration.
Tout d’abord, le courage. Pas le courage banal de l’affrontement physique ou de l’assaut sur la tranchée ennemie, mais le courage bien plus difficile de défendre ses propres idées. Si l’on réfléchit d’une certaine façon, si l’on a une certaine analyse des choses et des êtres humains, du monde et de ses facettes, il faut avoir le courage d’aller jusqu’au bout, sans compromis, sans demi-mesures, sans pitié, sans illusions. S’arrêter à la moitié du chemin est criminel, ou, si l’on préfère, absolument normal. Mais le révolutionnaire n’est pas un être humain « normal ». Il doit aller plus loin, au-delà de la normalité, mais au-delà aussi du caractère exceptionnel, qui n’est rien d’autre qu’une façon aristocratique de considérer la différence. Au-delà du bien, mais aussi au-delà du mal, comme dirait quelqu’un.
Un compagnon ne peut attendre que d’autres fassent ce qui doit être fait. Il ne peut déléguer à d’autres ce que sa conscience lui dicte de faire. Il ne peut accepter paisiblement qu’à d’autres endroits, d’autres personnes, tout autant emportées et désireuses que lui de détruire ce qui les opprime, fassent ce qu’il pourrait faire lui-même s’il le voulait, s’il se libérait de la torpeur et de la tromperie, du bavardage et des malentendus. Voilà pourquoi il doit travailler, et travailler dur. Travailler pour se donner les moyens nécessaires et poser ainsi de meilleures bases à ses propres convictions.
Ce qui nous amène au deuxième point : la constance. La force de continuer, de persévérer, d’insister – même quand les autres se découragent et que la situation semble difficile.
La persévérance est une condition indispensable à l’acquisition des moyens nécessaires. Un révolutionnaire a besoin d’outils culturels : analyses, connaissances de base et approfondissement du fonctionnement des institutions. Même des sujets qui semblent pourtant bien éloignés de la pratique révolutionnaire sont indispensables à l’action : langues, économie, philosophie, mathématiques, sciences physiques, chimie, sciences sociales, etc. Ces connaissances ne doivent pas être envisagées comme des secteurs de spécialisation, pas plus d’ailleurs comme une activité frénétique qui passerait sans cesse d’une idée à une autre, avide de savoir sans pouvoir sortir de l’ignorance en l’absence d’une méthode d’apprentissage appropriée. Il lui faut aussi des techniques : savoir écrire correctement (d’une manière adaptée au but qu’il s’est fixé), parler (toutes les techniques d’expression orale, difficiles mais d’une grande importance), étudier (comme une technique en soi afin de faciliter l’apprentissage, et non comme une forme de spécialisation), travailler sa mémoire (qui peut être améliorée, et ne doit pas rester au niveau plus ou moins naturel de notre enfance), savoir manipuler des objets et donc être habile de ses mains (ce que beaucoup considèrent comme un don mystérieux de la nature, mais qui peut en fait être appris et amélioré) et bien plus encore. La recherche des moyens est infinie, et le révolutionnaire se concentre de façon constante à leur perfectionnement et leur extension vers d’autres champs.
Nous en arrivons à un troisième point : la créativité. L’ensemble des moyens obtenus serait improductif et se noierait dans une spécialisation stérile s’il ne provoquait pas, immédiatement ou après un certain temps, de nouvelles expériences qui transforment profondément l’individu. Ces expériences créent à leur tour et sans arrêt, des modifications de l’ensemble des moyens et de leurs applications possibles. C’est alors que l’on peut saisir la force de la créativité, fruit des efforts précédents. Les processus logiques deviennent moins apparents, sous-jacents, négligeables, tandis qu’émerge un nouvel élément d’une toute autre nature : l’intuition.
On observe maintenant le problème d’une toute autre manière. D’innombrables liens et comparaisons, analogies et déductions se font sans même que l’on s’en rende compte. L’ensemble des moyens acquis vibre et devient vivant. Des souvenirs, de nouvelles et d’anciennes conceptions qui n’avaient pas été comprises, s’éclaircissent soudainement, se font idées, tensions. Ce mélange incroyable, lui même impulsion créatrice, doit immédiatement être soumis à une discipline méthodique et appliquée aux techniques, afin qu’il puisse engendrer quelque chose, de limité peut être, mais immédiatement perceptible et fertile. Malheureusement, cette créativité première, aux potentialités immenses et explosives (réduite à sa forme la plus pauvre en l’absence des moyens appropriés) devra ensuite être réintégrée dans le cadre plus limité des techniques, pour devenir mot, page, forme, son, objet. Autrement, en dehors des schémas de cette petite prison permettant la communication, elle ne peut que retomber et se disséminer aux quatre vents.
Un dernière point enfin : la matérialité. La capacité de comprendre les fondements matériels de la réalité qui nous entoure. Il n’est pas évident de comprendre quels sont les moyens nécessaires à l’action. Cette question simple est, en fait, à l’origine de nombreux malentendus. Prenons par exemple la question de l’argent. Sans argent, impossible de réaliser ce que nous voulons. Et il est clair qu’un révolutionnaire ne demandera pas de subventions à l’État pour élaborer des projets qui visent justement à sa destruction. Tant pour des raisons éthiques que logiques, sans compter que l’État ne les lui donnerait jamais. On ne peut pas non plus penser sérieusement que c’est avec nos petites (et modestes, de fait) contributions, que l’on pourra faire tout ce que nous pensons nécessaire. Pas plus que de se lamenter à l’infini ou de se résigner à ne pas accomplir nos projets par manque de fonds. Enfin, il serait trop facile d’adopter la position de celui qui, sans argent, se sent parfaitement en règle avec lui-même alors qu’il ne participe pas à l’effort collectif, préférant attendre que les autres en trouvent à sa place. Il est évident que si un compagnon n’a pas d’argent, il n’a pas à payer ce qu’il ne peut pas se permettre. La question est de savoir s’il s’est vraiment donné les moyens d’en trouver. Ou bien n’existerait-il qu’une seule façon : faire la manche en se laissant exploiter par les patrons ? Je pense que non.
Dans toute la palette possible des manières d’être, les tendances personnelles et les acquis culturels ont tendance à se polariser en deux comportements extrêmes, tous deux limitants et pénalisants. D’un côté, celui qui privilégie le moment théorique, de l’autre celui qui s’enferme dans l’instant pratique. Ces deux polarisations ne se retrouvent quasiment jamais séparées de façon aussi claire, mais sont souvent suffisamment présentes pour devenir des obstacles.
Les grandes possibilités que l’approfondissement théorique offre au révolutionnaire restent lettre morte quand elles sont exacerbées à l’infini, pire, vont jusqu’à devenir éléments de contradiction et obstacles. C’est le cas de ceux qui ne font rien d’autre que de penser la vie sur un plan théorique. Ils ne sont pas forcément étudiants ou érudits (pour qui cette activité serait presque normale), mais peuvent aussi être n’importe quel prolétaire ou marginal à la tête brûlée ayant grandi dans la rue. La recherche de l’hypothèse décisive par un raisonnement lucide dégénère en une peur abstraite, un désir tumultueux de comprendre, qui se transforme en pure confusion, réduisant ainsi la force prépondérante de l’intelligence que l’on avait pourtant comme première exigence. Ces états d’exaspération réduisent la possibilité critique d’organiser nos propres idées. En étendant la possibilité créatrice de l’individu mais en la limitant à un état basique, un état quasi sauvage pour ainsi dire, ils finissent par en donner une image et un jugement privés de toute méthode organisatrice qui les rendrait inutilisables. Vivant une sorte de transe, en se nourrissant mal, en entretenant un rapport détestable à son propre corps et des rapports compliqués avec les autres, on devient facilement méfiant, anxieux de vouloir se faire comprendre à tout prix jusqu’à aboutir parfois à une accumulation de raisonnements contradictoires dénués de fil conducteur. Pour sortir du labyrinthe, l’action semble alors la solution appropriée. Mais l’action, en raison encore de cet effet de polarisation des extrêmes, doit d’abord toujours être soumise à la suprématie du cerveau, de la logique, du raisonnement. Elle serait sinon tuée dans l’œuf, reportée, ou encore mal vécue parce mal comprise, n’ayant pas été réellement examinée à la lumière de la pensée.
À l’autre extrême, il y a l’action permanente, l’absorption de sa propre existence dans les choses à accomplir. Aujourd’hui, demain. Jour après jour. Dans l’attente peut-être d’un jour particulier qui viendrait mettre fin à cette perpétuelle course en avant. Et dans le même temps personne ou presque, n’est à la recherche de moments de réflexion qui seraient totalement séparés des choses à faire. La suprématie de l’acte tue autant que la suprématie de la pensée. L’action – cela va de soi – n’entraîne pas le dépassement de l’élément contradictoire de l’individu. Pour le révolutionnaire lui-même, les choses sont encore pires. La foule des arguments classiques qu’un individu développe pour se convaincre de l’utilité et de la complémentarité de l’action qu’il veut réaliser ne peut pas suffire au révolutionnaire. Sa seule option serait d’espérer des jours meilleurs où il ne serait plus nécessaire de se préoccuper exclusivement d’agir et où l’on pourrait aussi penser. Mais comment peut-on penser quand on n’en a pas les moyens ? Le fait de penser serait-il une activité automatique de l’être humain qui commencerait aussitôt que celui-ci cesse d’agir ? Certainement pas. De la même manière que l’on n’agit pas automatiquement lorsqu’on arrête de réfléchir.
En ayant ces quelques choses entre les mains – courage, constance, créativité, matérialité – le révolutionnaire peut mettre à profit les moyens dont il dispose et élaborer son projet.
Ce projet devra englober à la fois les aspects analytiques et les aspects pratiques. Ici, surgit à nouveau une division qui, pour être éliminée, doit être creusée, creusée jusqu’à sa dimension réelle, en tant que lieu commun de la logique dominante. Un projet est analyse (politique, sociale, économique, philosophique etc.) mais aussi proposition organisationnelle.
Aucun projet ne peut se contenter de n’être que l’un ou l’autre. Chaque analyse peut permettre un autre angle d’attaque et une élaboration différente selon la proposition dans laquelle elle est insérée. Et à l’inverse, une proposition organisationnelle perd toute sa valeur si elle n’est pas soutenue par une analyse adéquate. Un révolutionnaire qui n’est pas capable de maîtriser l’analyse et l’élément organisateur de son projet, restera toujours le jouet des événements ; il courra derrière les faits sans jamais pouvoir les anticiper.
En fait, le but du projet est de voir pour prévoir. Le projet est une prothèse, tout comme n’importe quelle autre élaboration intellectuelle de l’être humain, qui permet l’action, la rend possible, sans la réduire à néant par un bavardage improvisé et inutile. Mais il n’en est pas non plus la « cause ». S’il est conçu avec pertinence, le projet est l’action elle-même, tout comme l’action est en elle même le projet dans la mesure où celle-ci lui permet de croître, de s’enrichir, de se transformer.
L’incompréhension de ces prémisses fondamentales du travail révolutionnaire provoque souvent confusion et frustration. De nombreux compagnons qui restent liés à des modes d’interventions que l’on pourrait qualifier de réflexes, subissent souvent de tels contrecoups de démotivation et de découragement. Un élément extérieur (quasiment toujours la répression) fait office de stimulant. Quand ce fait s’arrête ou s’épuise, l’intervention n’a plus de raison d’être. C’est ce constat (frustrant) qui crée le sentiment de devoir repartir à zéro. Comme si l’on devait creuser un tunnel sous une montagne avec une petite cuillère. Les gens ne se souviennent pas et oublient vite. L’agrégation ne prend pas. Nous sommes toujours aussi peu nombreux. Quasiment toujours les mêmes. Dans l’attente du prochain stimulant extérieur, les expériences du compagnon qui ne sait agir que par réflexe, survivent sous forme d’un refus radical qui l’amène à se replier sur lui-même, dans un mutisme indigné qui peut conduire jusqu’aux fantasmes de destruction du monde (êtres humains inclus).
De nombreux autres compagnons se consacrent plutôt à des interventions que l’on pourrait qualifier de routine, sur le plan littéraire par exemple (journaux, revues, livres) ou à des activités répétitives qui relèvent de l’assemblée (congrès, conventions, débats). Là aussi, la tragédie humaine ne tarde pas. Souvent, il ne s’agit pas tant d’une frustration personnelle (quoique il y en ait – et cela se voit) que de la transformation de ces compagnons en bureaucrates de congrès ou en rédacteurs de pages plus ou moins lisibles, cherchant à dissimuler leur propre inconsistance par des propositions qui courent derrière l’événement pour tenter de l’éclaircir à la lumière critique de leurs propres analyses. C’est toujours la même tragédie.
Le projet est donc nécessairement une proposition. Il est l’élément qui vient souder l’affinité. De la connaissance réciproque entre des compagnons d’un groupe affinitaire, cette affinité débouche sur le champ projectuel où elle grandit et commence à porter ses fruits. En tant que proposition, le projet ne peut pas ne pas prendre l’initiative, qui sera avant tout de nature opérationnelle (les choses à faire étant considérées sous l’angle que l’on a déterminé), puis de nature organisationnelle (la manière dont on veut les faire).
Beaucoup ne se rendent pas compte que les choses à faire (l’antagonisme des classes) ne sont pas codifiées une fois pour toutes, mais acquièrent, à travers le temps et le développement des rapports sociaux, des significations différentes. Cela nécessite une évaluation théorique des objectifs. Le fait qu’un certain nombre de choses semblent rester longtemps sur place comme si elles étaient immobiles, ne signifie pas qu’elles ne se transforment pas. Par exemple, la nécessité de s’organiser pour frapper l’ennemi de classe, en fait une préoccupation qui perdure dans le temps. Les moyens et les façons de s’organiser tendent à se cristalliser. Et à certains égards, c’est plutôt une bonne chose. Il n’est pas nécessaire de réinventer l’eau chaude à chaque fois que l’on s’organise, après des vagues répressives, par exemple. Mais cela ne veut pas dire que cette « réutilisation » doit être en soi une répétition absolue. Les modèles déjà employés peuvent être soumis à la critique, même si au final, ils restent valides et peuvent donc rester un point de départ significatif. Cette question fait souvent l’objet de critiques, même si elles sont mal informées et empreintes de préjugés. L’intransigeance, même si elle peut aussi être considérée comme une appréciation positive, peut parfois relever de l’incapacité à comprendre l’évolution des rapports sociaux dans leur ensemble.
Il est donc possible de réutiliser des modèles d’organisation, s’ils sont soumis à une critique radicale au préalable. Une telle critique englobe un certain nombre d’aspects : la dénonciation de l’inutilité et de la dangerosité des structures centralisées et organisées, de la mentalité de délégation, du mythe du quantitatif, des mythes du symbolique et du grandiose, de l’utilisation des médias etc. Il s’agit ici de critiques qui tendent vers l’autre versant du ciel révolutionnaire, le versant anarchiste et libertaire. Refuser des structures centralisées, des organigrammes dirigeants, la délégation, le quantitatif, le symbolique, l’entrisme informatif, etc, signifie entrer à pieds joints dans la méthodologie anarchiste. Et une proposition anarchiste nécessite quelques considérations préliminaires.
Pour ceux qui ne sont pas profondément convaincus de la nécessité et de la validité de cette méthode, elle peut sembler au début moins efficace (et à certains égards, c’est effectivement le cas). Les résultats sont plus modestes, moins évidents, semblent dispersés sans converger vers un projet unitaire. Ce sont des résultats disparates et diffus provenant d’objectifs minimaux et qui ne semblent pas se diriger immédiatement vers un ennemi central – du moins comme cela apparaît dans les iconographies descriptives faites par le pouvoir lui-même. Le pouvoir a très souvent intérêt à présenter ses ramifications périphériques et toutes les structures qui les gèrent, sous un angle positif, comme si elles assuraient des fonctions indispensables à la vie sociale. Il cache d’ailleurs très bien, et assez facilement compte tenu de notre incapacité à dénoncer les connexions, le rapport entre ces structures périphériques et la répression ou la fabrication du consensus. C’est là une tâche considérable du révolutionnaire, qui lorsqu’il frappe, doit aussi s’attendre à ce que ses actions ne soient pas immédiatement comprises, ce qui nécessitera de les clarifier. De là peut apparaître un autre piège. Même lorsque l’on agit de façon diffuse et décentralisée, traduire ces clarifications en termes idéologiques présente les conditions exactes de la concentration et de la centralité. Jamais la méthode anarchiste ne saurait s’expliquer à travers un filtre idéologique. À chaque fois que cela s’est produit, cette méthode se voyait simplement rangée à côté d’autres pratiques et de projets bien peu libertaires.
Le refus de la délégation comme pratique non seulement nocive mais aussi autoritaire (le second argument pourrait sembler moins évident pour des compagnons qui ne sont pas anarchistes depuis longtemps), amène à un approfondissement des processus d’agrégation. Il ouvre la possibilité de construire une agrégation indirecte basée sur l’affinité et l’informalité, une forme de référence organisationnelle qui n’est pas conditionnée sous forme d’organigrammes. Une agrégation de différents groupes, rassemblés autour de leurs affinités et d’une méthode commune, plutôt que par des rapports hiérarchiques. Des cibles et des choix communs, mais qui seraient établis de façon indirecte, comme le résultat objectif de choix, d’analyses et de buts partagés. Chacun fait ses propres choses et personne ne ressent le besoin de proposer des rapports d’agrégation directe qui tôt ou tard engendrent des organigrammes hiérarchiques (fussent-ils horizontaux lorsqu’ils sont élaborés d’après la méthode anarchiste) et qui ont comme résultat fantastique d’être détruits à chaque tempête répressive. C’est le mythe du quantitatif qui doit s’effondrer. Le mythe du nombre qui impressionne l’ennemi, des « forces » à faire descendre dans l’arène, de « l’armée de libération » et d’autres choses du même acabit.
Ainsi, presque sans le vouloir, les vieilles choses se transforment en nouvelles. Les modèles du passé, les objectifs et les pratiques sont révolutionnés de l’intérieur. Émerge sans l’ombre d’un doute la fin définitive de la méthode politicienne et de la prétention à représenter des modèles idéologiques qui s’imposeraient aux pratiques subversives.
Sous d’autres aspects et dans certaines proportions, le monde entier est en train de rejeter le modèle politique. La « fin » de la politique est devenue chose courante. Les structures politiques traditionnelles et leurs lourdes connotations ont sombré ou sont sur le point de le faire. Les partis de gauche rejoignent ceux du centre et les partis de droite s’en rapprochent toujours plus pour ne pas se retrouver isolés. Ce délabrement des échafaudages politiques correspond à une transformation profonde des structures économiques et sociales. De nouvelles nécessités s’imposent à ceux qui doivent penser la gestion de la potentialité subversive des masses. Les mythes du passé, comme celui de « la lutte de classe contrôlée », arrivent à leur fin. Les grandes masses des exploités sont englouties dans des mécanismes qui sont en porte-à-faux avec les idéologies politiques d’hier, plutôt claires mais en définitive assez superficielles. Voilà pourquoi les partis de gauche se rapprochent du centre, procédant ainsi à un anéantissement des différences politiques et permettant une gestion du consensus d’un point de vue administratif. Seules les choses à faire dans l’immédiat, les programmes à court terme, la gestion des affaires publiques font la différence. Les projets politiques idéalistes (et donc idéologiques) sont dépassés. Personne (ou presque personne) n’est prêt à lutter pour une société communiste, mais chacun peut bien être embrigadé une énième fois dans des structures qui prétendent servir ses intérêts immédiats. Voilà pourquoi la croissance des luttes et de la politique locale est importante, face aux structures politiques plus grandes, aux parlements nationaux et supranationaux.
Ce déclin de la politique ne peut pas être interprété comme un quelconque virage « anarchiste » dans la société, qui aurait pris conscience de ses propres forces et s’opposerait aux tentatives de gestion politique indirecte. Rien de tout cela. Il résulte de transformations profondes dans la structure moderne du capital qui apparaissent aussi au niveau international du fait de l’interdépendance croissante des différentes réalités périphériques. Face à ces mutations, les mythes politiques permettant un contrôle du consensus deviennent à leur tour inutiles, entraînant l’apparition de méthodes de contrôle plus adaptées à notre époque.
Aussi étrange que cela puisse paraître, cette crise généralisée de la politique entraîne de toute façon une crise des rapports hiérarchiques, de la délégation etc, de tous ces rapports qui tendent à diluer les enjeux réels des contradictions de classe dans une dimension idéologique. Tout cela ne peut pas rester longtemps sans conséquences, entre autres sur la capacité de nombreuses personnes à comprendre que la lutte ne peut plus passer par les mythes de la politique, mais doit entrer dans la dimension concrète de la destruction immédiate de l’ennemi.
Il y en a aussi qui ne veulent pas comprendre ce que doit être la tâche d’un révolutionnaire et qui, face à ces bouleversements sociaux, deviennent partisans de méthodes d’opposition douces et prétendent faire obstacle à la nouvelle domination en usant de résistance passive. Il s’agit là selon moi d’une erreur, qui s’appuie sur l’idée que le pouvoir moderne – justement parce qu’il est plus permissif et plus largement basé sur le consensus – serait moins « fort » que l’ancien, basé sur la hiérarchie et la centralisation absolue. Cette erreur résulte du fait qu’en chacun de nous subsistent les décombres de l’amalgame « pouvoir – force », que les structures modernes de la domination démantèlent petit à petit. Un pouvoir faible mais effectif est peut-être un pouvoir plus efficace qu’un pouvoir brutal mais grossier. Le premier pénètre dans le tissu psychologique de la société, s’insinuant dans chaque individu en l’incluant ; le deuxième reste extérieur, aboie et mord, mais ne dresse finalement que des murs de prisons qui seront escaladés tôt ou tard.
La multiplicité des aspects d’un projet offre également une perspective multiple au travail d’un révolutionnaire. Aucun terrain d’activité ne peut être exclu à priori. Pour les mêmes raisons, il ne peut y avoir de terrains d’intervention privilégiés, qui seraient « innés » pour chaque individu. Je connais des compagnons qui ne se sentent pas portés vers certains domaines d’intervention – comme la lutte de libération nationale par exemple- ou certaines pratiques révolutionnaires comme l’action minoritaire spécifique. Ces objections sont très diverses, mais sont toutes réductibles à l’idée (fausse) que chacun doit faire les choses qui lui procurent la plus grande satisfaction. S’il est juste que l’un des ressorts de l’action est justement la joie et la satisfaction personnelle, il serait faux de penser que cette motivation individuelle peut exclure une recherche plus vaste et plus significative, une recherche qui vise la totalité de l’intervention. Se baser sur des idées préconçues quant à certaines pratiques ou théories signifie se retrancher – seulement par « peur » – derrière le fait, presque toujours illusoire, que ces pratiques ou théories ne nous conviennent pas. Mais un préjugé est toujours fondé sur une faible connaissance de ce que l’on refuse, sur l’insuffisance ou l’incapacité à s’en approcher. La satisfaction et la joie instantanées sont ainsi érigées en but définitif, et enferment les perspectives futures dans leur immédiateté. On devient alors et sans le vouloir, craintif et dogmatique, envieux de ceux qui parviennent à surmonter ces obstacles, déçu, malheureux ou méfiant à l’égard de tous ceux qui nous approchent.
La seule limite acceptable est celle de nos propres possibilités (limitées). Une limite qui ne s’établit que par une expérience personnelle et concrète ne saurait être posée à priori. Je suis toujours parti de l’hypothèse (évidemment absurde, mais réelle en termes opératifs) que je n’avais pas de limites et que je disposais de possibilités et d’immenses capacités. C’est dans la pratique quotidienne qu’apparaissent mes limites objectives et les limites des choses que je suis en train de faire. Mais elles ne m’ont jamais retenu à priori, elles ont surgi au fur et à mesure comme des obstacles incontournables. Aucune entreprise, aussi incroyable et gigantesque soit-elle, ne m’a jamais bloqué avant qu’elle ne soit engagée. C’est après seulement, au cours des pratiques qui y sont liées, que la modestie de mes moyens et de mes capacités m’est apparue. Mais cette modestie ne m’a jamais empêché d’atteindre un but partiel, ce qui, en fin de compte, est le seul objectif qu’un être humain puisse atteindre.
C’est aussi un problème de mentalité, une façon de voir les choses. On reste souvent trop lié à ce qui n’est perceptible que dans l’immédiat, au réalisme socialiste du quartier, de la ville, de la nation, etc. On est internationaliste dans les mots, mais dans les faits, on préfère ce que l’on connaît le mieux. On s’enferme alors tant vers l’intérieur que vers l’extérieur. On récuse les rapports internationaux réels, les rapports de compréhension réciproque, le dépassement des frontières (entre autres linguistiques), la coopération et l’échange. Et l’on refuse aussi les rapports locaux spécifiques avec leurs caractéristiques, leurs contradictions internes, leurs mythes et leurs difficultés. N’est-il pas comique de refuser les rapports internationaux au nom du local, et les rapports locaux au nom de l’international.
Le même mécanisme concerne souvent les activités spécifiques et préparatoires à l’acquisition des moyens révolutionnaires. Là aussi, la délégation à d’autres compagnons est souvent décidé d’emblée. En fin de compte, celui qui s’en tient aux craintes et aux hésitations n’a pas grand-chose à dire. Si le professionnalisme a été banni et n’a pas sa place dans la méthode anarchiste, le refus à priori ou la fermeture d’esprit basée sur des idées préconçues non plus. Il en va de même pour la fébrilité de l’expérience comme but en soi, l’urgence de l’agir, la satisfaction personnelle, le frisson. Les deux extrêmes se touchent et tendent à se confondre.
Le projet élimine ces problèmes parce qu’il permet de voir les choses dans leur ensemble. C’est pour cette raison que le travail du révolutionnaire est nécessairement lié au projet, s’identifie à lui, et ne peut se limiter à des aspects partiels. Un projet partiel n’est pas, en soi, un projet révolutionnaire. Il peut être une excellente base de travail, sur laquelle s’engagent des compagnons et leurs ressources pour de longues périodes. Mais tôt ou tard, la réalité de l’affrontement des classes finit par en dévoiler les limites.
Alfredo M. Bonanno
Il lavoro del rivoluzionario, dans Anarchismo, n° 59, Italie, 1988 ; traduction publiée dans Alfredo M. Bonanno, Qui a peur de l’insurrection ?, Tumult Editions, Bruxelles, 2012