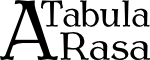Les voyages de Prométhée (mai 2010)
A propos de la guerre sociale en Grèce et la fin d’un ici et d’un là-bas
Le miroir de la paix sociale commence à se fissurer. La date limite de conservation de l’Etat-providence à l’européenne semble dépassée et l’une après l’autre, les classes politiques nationales en prennent acte. Tandis que dans certains pays les bases juridiques pour ce tournant ont déjà été posées dans les parlements dans une relative tranquillité, les hostilités en Grèce ont pris une ampleur inattendue. Même si cette conflictualité pourrait être placée dans la continuité de mouvements sociaux contre le démantèlement de l’« Etat social » auxquels nous sommes habitués, elle tend à prendre un caractère considérablement différent. Un accord avec l’Etat dans la logique de l’ancien pacte social paraît de plus en plus improbable, car il n’existe plus les bases économiques, politiques et sociales pour cela. Nous sommes donc face à une nouvelle donne. Habitués à mener des luttes visant à briser la pacification sociale et le consensus autour, nous pourrions être rapidement confrontés avec une nouvelle forme de gestion qui tend plutôt à instaurer un climat de guerre. C’est pourquoi il est d’autant plus nécessaire de développer des nouvelles perspectives, de nous risquer à formuler quelque nouvelle hypothèse pour la guerre sociale.
D’autres horizons…
Les restructurations advenues au sortir de la Seconde Guerre mondiale ou après des phases de dictature ont joué pendant des années sur un Etat social capable d’accompagner cette refondation du capitalisme et d’en gérer les tensions. Cependant, depuis les années 80, les dits « acquis sociaux » ont été largement attaqués, et au cours des années 90 leur déconstruction et leur morcellement se sont accélérés à un rythme déterminé par le contexte international et les rapports de force locaux. La flexibilisation du marché du travail, le démantèlement de la protection sociale comme du système de retraites, la libéralisation puis la privatisation de secteurs comme l’énergie, les communications et les transports ont signifié autant de remises en cause de ce que beaucoup considéraient comme des certitudes.
La « crise financière » de l’année passée n’est en fait pas une crise, mais une conséquence de ces nouvelles restructurations. Au delà des sommes énormes provisoirement dégagées par nombre d’Etats pour le « sauvetage » de quelques banques, se sont surtout les ventes d’établissements et d’industries « publics » qui se sont poursuivies. Pour autant, les Etats restent en déficit colossal, et ont déjà épuisé quelques unes des recettes susceptibles de renflouer leurs caisses. Ils doivent donc continuer à tailler dans le vif. La situation actuelle en Grèce nous donne un avant-goût de ce qui nous attend dans d’autres pays.
Les plans d’austérité qui se mettent d’ores et déjà en place en Angleterre comme en Espagne, en Italie, en Grèce ou dans bien d’autres pays européens vont diamétralement à l’encontre de ce qui a été pendant des décennies l’un des paradigmes de « l’Etat social » : l’augmentation de la consommation sur le marché intérieur. D’un côté, l’Etat grec réduit l’accès à la consommation (avec les réductions de salaires et des retraites) et de l’autre, il augmente drastiquement les impôts directs ou indirects pour récupérer encore de l’argent. L’objectif affiché n’est plus l’« inclusion des pauvres », il est assumé que toute une part de la population exposée à la misère doit se soumettre à une exploitation renforcée et s’en estimer heureuse. Depuis des années, cette direction a aussi été prise dans la politique d’immigration européenne. Face à une immigration toujours croissante, la prétendue Europe Forteresse gère toujours les flux humains à coups de régularisations et de renforcements de la capacité d’expulsion, mais en lien étroit avec des contrats du travail de plus en plus précaires. L’existence d’une sous-couche de la population est donc clairement acceptée et appréciée selon les besoins du marché.
Certains conflits de ces dernières années ont déjà donné des signes (Argentine en 2001 ou Bangladesh notamment en 2006) d’une exacerbation de la guerre économique. Ce qui se passe actuellement en Grèce vient le confirmer en Europe. Quoique des temps toujours plus sombres s’annoncent, et ce n’est pas la faiblesse actuelle de la critique sociale et révolutionnaire qui le démentira, nous avons pourtant l’intuition que pour nous aussi des temps nouveaux pourraient s’annoncer, des temps qui ouvriraient des possibilités perdues de vue, et certainement pas en suivant des raisonnements du type « le pire c’est mieux ». Même si la surprise peut être un sentiment plutôt agréable, nous devrions donc tout mettre en œuvre pour ne pas vivre les défis actuels en commentateurs impuissants, noyés dans la passivité que la domination essaye de nous faire avaler.
Au pays de Prométhée
Il faut revenir assez loin dans l’histoire pour retrouver un moment et un espace où le mouvement révolutionnaire – de plus en grande partie antiautoritaire – a été capable d’approcher les développements et la lutte sociale comme c’est aujourd’hui le cas en Grèce. C’est le résultat provisoire d’années de pollinisations croisées entre le mouvement anarchiste grec, dans toute sa diversité, et une certaine combativité sociale. Les anarchistes grecs se sont souvent retrouvés côte à côte avec des opprimés qui se soulevaient, tout en étant capables de mener des luttes quand tout le monde regardait de l’autre côté. De cela, nos ennemis en sont conscients au moins tout autant que nous. Non seulement la Grèce a été le premier pays de la zone euro à devoir prendre des mesures drastiques contre les exploités ; non seulement elle a été et reste une base d’opérations militaires notamment vers les Balkans, en même temps qu’une porte de l’Europe pour l’immigration venant de l’Est ; mais c’est aussi un pays confronté à des tensions sociales importantes et une activité révolutionnaire acharnée.
Maintenant que la gauche institutionnelle est au pouvoir, elle peut difficilement jouer de la même manière son rôle de récupérateur et de frein de la lutte sociale. Cette carte, elle l’a déjà jouée lors de son élection sur un « programme progressiste » suite à l’explosion de révolte de décembre 2008. La marge de la classe politique grecque s’est donc considérablement réduite, et en cas d’extension et de durcissement du conflit, deux voies – historiquement classiques – s’offrent à elle : soit la droite dure, répondant aux exigences du capital national et international et s’appuyant sur un patriotisme latent, réussit à rétablir l’ordre à l’aide d’un gouvernement technique et d’une poigne de fer ; soit surgit à l’horizon la possibilité d’une insurrection. Il y a beaucoup en jeu.
Pendant quasi toute l’année 2009, la Grèce a été secouée par une longue série de grèves, de blocages, de manifestations et d’attaques contre les structures du pouvoir. Grande fut la perturbation de l’économie quand des milliers d’agriculteurs ont bloqué les autoroutes et les ports, montrant ainsi la possibilité d’une autre manière d’envisager la lutte que les grèves et les manifestations dirigées par les syndicats. Confronté à une hausse de la spéculation sur la dette de l’Etat (notons que la majeure partie de la dette grecque est dans les mains des banques « grecques ») et à l’explosion du déficit budgétaire, le gouvernement socialiste est passé début 2010 en cinquième vitesse, provoquant également une accélération des mouvements de protestations. Il n’est pas exagéré de parler d’un « climat de guerre », tant au niveau économique qu’au niveau social et politique. De début 2009 jusqu’à maintenant, le gouvernement a tranché à la hache dans les salaires et les retraites (avec des réductions allant de 10 à 30 %), a augmenté les impôts directs et indirects, a restructuré l’enseignement et quasi aboli la santé publique. Pour pouvoir maintenir les structures de l’Etat, la classe politique et l’élite économique doivent rapidement transformer la Grèce en paradis de l’exploitation, en fer de lance de la zone euro. L’Etat grec déclare ouvertement la guerre aux classes d’en bas, et sa « préoccupation pour le peuple » prend clairement la forme du patriotisme et d’une mise en spectacle d’un « terrorisme révolutionnaire qui menace la société ».
La situation est plutôt critique pour les institutions existantes, et il y a longtemps qu’un Etat européen n’avait senti de nouveau dans son cou l’haleine chaude d’une possible insurrection. Mais n’allons pas trop vite en besogne. Malgré des échauffourées significatives mais circonscrites (lors de la manifestation du 5 mai 2010 à Athènes, le leader du syndicat GSEE n’a pu dire deux mots avant d’être chassé par des centaines de manifestants), une grande partie des protestations respectent les consignes des syndicats sociaux-démocrates, du parti stalinien KKE et de quelques structures de gauche comme le PAME, notamment parce que ceux-ci se trouvent encore à la base de quelques initiatives formelles comme les grèves générales. Malgré de nombreuses expériences pratiques d’auto-organisation dans la rue (lors des manifestations, des occupations et des émeutes), les protestations négligent encore la confirmation nécessaire de leur autonomie. Combiné à une répression policière plutôt brutale et une terreur médiatique, le danger existe de se laisser entraîner dans une guerre d’usure. Sans vouloir prétendre que la grève générale illimitée (contrairement aux « journées d’action » de 24h) serait le présage d’un moment insurrectionnel, il est sans doute nécessaire de paralyser l’activité économique et la circulation de marchandises. Pour cela, il faudrait pousser vers une décentralisation des initiatives ou, en d’autres termes, vers une auto-organisation assumée de la lutte afin d’arracher l’initiative aux syndicats et de créer un espace qui résiste aux rappels à l’ordre. Une des possibilités semble être d’œuvrer de manière décentralisée et diffuse à la paralysie de l’infrastructure économique. Cette question ne concerne pas que la minorité révolutionnaire comme certains pourraient le croire, c’est au contraire une proposition pratique qui s’adresse à tout le monde, qui se nourrit de beaucoup d’expériences, et dans laquelle la créativité et la diffusion l’emportent sur toute conception économiste ou militariste.
Il est ainsi clair que la question de l’auto-organisation va bien au-delà de la problématique d’arriver à une paralysie diffuse de l’infrastructure économique. Celle-ci n’est qu’une partie, bien que nécessaire, du chemin, ou plutôt, des chemins qu’emprunte la subversion. A l’heure actuelle, les occupations autogérées et les assemblées de quartiers, d’écoles,... se multiplient. Le défi est alors qu’elles ne se considèrent pas comme une des possibles options d’opposition à l’état des choses, une parmi les syndicats et les partis. Le défi est qu’elles rejettent la politique, qu’elles se munissent d’une force de communication vers d’autres révoltés, et en une force muette et hostile face à toutes les institutions, mêmes « oppositionnelles ». Dans ce sens, un projet de constitution de syndicats de base, comme il en est question, risque, au-delà des autres problématiques que pose la logique anarcho-syndicaliste, de tomber bien vite dans le piège de se retrouver – malgré lui – sur le terrain de l’ennemi. L’auto-organisation se meurt dès qu’elle est conçue comme une forme de contre-pouvoir (peu importe si elle se pare de l’ancienne étiquette de « dictature du prolétariat », de la plus moderne « autonomie de classe » ou du récent « réseau horizontal »). Pas seulement parce qu’alors, elle finirait très vite par reproduire tous les mécanismes de la politique et de l’autorité en son sein (la représentation et la hiérarchie), mais aussi parce qu’elle sera amenée à laisser intactes les structures de l’ennemi, en apparence négligeables et affaiblies. Ces constats ne sont pas nouveaux, ils proviennent aussi bien des expériences de la Commune en 1871, des conseils ouvriers, de la révolution espagnole en 1936 ou plus récemment du soulèvement populaire en Argentine en 2001. Rappelons aussi que le déclin de l’élan d’auto-organisation est toujours allé de pair avec les questions liées à la survie. Et si ces questions étaient complexes il y a cent ans, elles le sont d’avantage aujourd’hui dans un monde où l’interdépendance technologique et industrielle pèse sur toute perspective de révolution sociale. Œuvrer à ce que ces questions soient présentes chaque fois que des expériences auto-organisées émergent n’est certainement qu’un premier pas.
Refuser le duel
L’insurrection n’est pas l’œuvre de révolutionnaires et d’anarchistes seuls. Elle est sociale, non seulement dans le sens où elle implique une partie considérable des exploités, mais surtout parce qu’elle bouleverse les rôles sociaux existants en détruisant les structures qui les soutiennent. Tout comme elle ne tire pas sur des exploités pour mettre fin à l’exploitation, mais sur les structures et les hommes qui rendent l’exploitation possible, elle ne peut pas se laisser coincer dans une apologie du « peuple » ou « des exploités » dont la résignation, voire le consentement, sont au bout du compte les forces qui font tourner la machine. La révolte de décembre 2008 a remis cette problématique au goût du jour, et toutes les propositions qui ont pu en sortir ont cherché à rompre l’encerclement de la résignation. Deux ans plus tard, avec un mécontentement qui semble être bien plus diffusé socialement, ces soucis prennent une autre tournure. Même si la résignation fait encore des ravages, il semble plus urgent de trouver d’autres chemins, des chemins qui n’amènent pas vers une fermeture, une stagnation du conflit, mais qui la feraient éclater au-delà des schémas de l’opposition politique. Si cette stagnation peut en effet prendre la forme d’une plongée du mécontentement dans la politique (avec par exemple les fausses pistes d’un « contre-pouvoir » quelconque, même assembléaire), elle pourrait aussi surgir d’une militarisation du conflit, au-delà des intentions des partisans du paradigme de la guérilla urbaine.
Lors des moments de hausse de la conflictualité sociale, l’Etat a tout intérêt à pouvoir présenter le conflit comme un combat singulier, comme un duel entre deux « factions » (dans ce cas-ci, l’Etat contre les adeptes de la « guérilla urbaine », avec la population en spectateur passif). Bien sûr, il est tout à fait capable d’utiliser le mouvement anarchiste dans son ensemble à cette fin, et de le faire avaler dans un grand spectacle, mais il ne semble pas très malin de lui faciliter la tâche en appliquant nous-mêmes – plus ou moins explicitement – des hiérarchies aux différentes formes d’attaques contre les structures de l’Etat et du Capital. L’insurrection n’a pas besoin d’avant-garde ou de protecteurs. Ennemie de tous les fétichismes, elle ne demande rien d’autre que la détermination d’insuffler la subversion à travers toute la société. Quand vient la question des armes, celle-ci devrait être posée dans la perspective d’armer tout le monde, d’une généralisation de l’offensive, pas en refoulant le fait armé vers tel ou tel groupe, acronyme ou faction.
L’Etat grec commence à insister sur une rapide militarisation du conflit, et il espère que les anarchistes en prennent l’initiative. Il intensifie ainsi la répression spécifique et la terreur contre le mouvement ; il a posé qu’il continuera à y avoir des morts, qu’il torturera désormais sous les yeux de tout le monde, qu’il n’hésitera pas à pousser toujours plus l’occupation militaire (par exemple d’un quartier comme Exarchia), qu’il utilisera ouvertement des escadrons para-étatiques et fascistes. L’Etat ne vise pas seulement à isoler les anarchistes de la lutte sociale, à briser leurs dynamiques, mais aussi à les entraîner dans une spirale où règne la loi du talion, avec des représailles certainement justes et courageuses, mais dont le prix pourrait être le recul de la subversion dans d’amples strates de la société. Il utilise sciemment les médias dans une optique purement contre-insurrectionnelle, en tentant de terroriser la population (avec le spectre des « hordes d’immigrés déferlant sur la Grèce », des « terroristes anarchistes », des « braqueurs sanguinaires »,…). L’Etat ne se maintient plus en achetant la paix sociale et la réconciliation, mais en déclarant toujours plus ouvertement la guerre à tous ceux qui luttent. Il n’est pas facile de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se retrouver pris dans les filets d’un conflit militaire qui serait sans doute le fossoyeur de n’importe quel projet de subversion. Comprenons-nous bien, car la situation actuelle commande de se parler clairement : ceci n’est pas un plaidoyer pour baisser les armes, il ne s’agit pas d’un discours qui pose que « la violence insurrectionnelle fait peur aux prolétaires et qu’il faut donc la limiter ». Au contraire, c’est justement le moment pour chacun, chacune, d’œuvrer pour forger les moyens qu’il ou elle veut utiliser ; de partager autant que possible la nécessité de l’attaque avec tous ceux qui refusent de s’incliner devant les autels de la Nation et de l’Economie ; de donner à l’attaque la place qu’elle devrait toujours occuper : un geste de destruction consciente d’une structure ennemie, et non pas un moyen de véhiculer sa propre autopromotion. La subversion recule lorsque les compagnons ne parlent qu’après avoir tiré une balle.
D’un ici et d’un là-bas
Maintenant que des possibilités longtemps mises au placard tentent d’envahir l’existant avec toute leur violence en Grèce, des questions s’imposent aussi aux compagnons hors de Grèce, des questions qui ne tolèrent pas de délais. Non seulement parce que ce qui s’y joue aura probablement un impact sur tous les anarchistes et révolutionnaires en Europe et ailleurs, mais surtout parce que la possibilité d’une contamination devient chaque jour plus imaginable. Nous ne voulons pas ressusciter une espèce de théorie domino, mais il nous semble clair qu’au vu de l’imbrication toujours plus étroite et profonde des structures économiques et étatiques sur le vieux continent (le projet de l’Union Européenne étant une de ses structures formelles), ce serait s’aveugler que d’intégrer les frontières des territoires où nous habitons, des Etats nationaux où nous menons nos luttes, comme des horizons infranchissables. La veille question de l’internationalisme s’impose aujourd’hui et exige de nouvelles réponses.
Ce sont en grande partie les mêmes questions qui sont venues frapper aux portes des compagnons en décembre 2008, mais les enjeux sont aujourd’hui encore plus exigeants. Quoique voyager en Grèce vaille certainement la peine pour échanger et partager des expériences, nous préférons nous demander comment nous pouvons aller plus loin dans nos contextes que d’exprimer une simple solidarité internationale ; comment faire pour que nos activités aillent au-delà d’une tape encourageante et généreuse dans le dos de nos compagnons grecs, qui ont aujourd’hui tellement à perdre, mais surtout à gagner ?
Considérons que, vu l’extension de la guerre sociale en Grèce, toutes les luttes et gestes de révolte prendront un poids plus lourd. Pas parce qu’ils exerceraient d’une manière ou d’une autre une pression directe sur les institutions grecques, mais justement parce qu’ils peuvent être les porteurs redoutés d’une contamination. En partie objectivement, et en partie en s’y efforçant, il est possible d’enchevêtrer les différentes luttes « locales » avec la guerre sociale en Grèce, et vice versa, parce que c’est la conséquence logique d’un lien social, d’une similarité de situations qui, comme nous le suggère notre intuition, pourraient se passer dès demain dans « nos » contrées. Même si on peut constater que les forces subversives sont beaucoup plus faibles dans beaucoup de pays et qu’elles doivent faire face à un certain consensus autour de la réaction (comme par exemple en Italie, où le racisme et la gestion politique prennent des allures totalitaires au travers de l’affreux consentement de larges couches de la population), s’impose donc la nécessité d’aller plus loin que la solidarité, et de réellement tisser des liens entre les différentes luttes. Chaque combat qui est actuellement mené pourrait alors avoir une signification qui le dépasse. La logique d’un ici et d’un là-bas pourrait enfin prendre fin, y compris dans nos perspectives.
Quoique la restructuration économique en cours semble vouloir faire d’une instabilité généralisée son champ d’accumulation, une autre instabilité est possible, qui ne profiterait cette fois pas à la domination. Il nous faut y réfléchir, sérieusement y réfléchir. Serait-il impossible d’arriver à quelques analyses et hypothèses qui lieraient le contexte local avec ce qui touchera probablement toute la zone euro, et ainsi de développer une capacité pour évaluer les luttes actuellement en cours en fonction de leurs effets possiblement déstabilisants ? Ce défi nous semble en tous cas valoir la peine d’être relevé, d’être posé là où un combat gagné dans cette guerre sociale diffuse pourrait dépasser son premier résultat concret, comme en essayant de concevoir nos activités à la lumière de leur rapport à celles qui se déroulent à quelques centaines de kilomètres de distance. Tenter d’aller sur ces chemins pourrait nous aider à développer des hypothèses insurrectionnelles, à éviter d’être trop pris par surprise, à découvrir des possibilités pour pousser le mécontentement et les rages présentes vers des perspectives émancipatrices, en direction d’une guerre sociale contre toute forme d’exploitation et d’autorité.
Le rêve
Une hypothèse insurrectionnelle n’a pas seulement besoin d’analyses et d’activités. Elle reste lettre morte ou un coup dans l’eau si elle ne sait pas communiquer son pourquoi. En ces temps incertains, elle ne peut plus s’appuyer sur la seule énonciation de quelques concepts qui restent vagues, même quand ils sont discutés, comme celui de libération. Les concepts rendus communicables à travers la lutte sociale n’existent plus. Nous devons oser nous poser la question de comment faire revivre un rêve, non pas comme un mirage, non pas comme un mythe, mais comme un ensemble d’intentions vivantes. La contribution révolutionnaire à la lutte sociale ne devrait pas simplement se limiter à des suggestions destructives, à inciter à la révolte. Son caractère insurrectionnel devient plus tangible quand elle réussit non seulement à identifier l’ennemi et à mettre en œuvre une négativité qui donne certainement du courage à tous les enragés et à tous ceux qui voudraient briser les chaînes de la résignation, mais aussi quand elle est capable de garder vivant, de communiquer, pour quoi elle lutte.
En ce sens, deux décennies d’idéologisation des idées révolutionnaires ont causé beaucoup de dégâts. Nous sommes orphelins d’idées qui semblent avoir perdu leur pensabilité. Nous devons forcer un passage pour sortir du coin dans lequel nous avons été acculés et arrêter d’en faire l’apologie pathétique. La conflictualité qui monte pourrait prendre un caractère assez différent de ce que nous avons connu jusqu’alors, elle nous offre de vraies possibilités d’expérimenter et de rompre l’encerclement idéologique. La contradiction de la subversion se cache dans la tension entre approcher la réalité et sortir de la danse, communiquer ce qui est considéré comme impossible.
Dans les temps qui viennent, beaucoup pourrait se jouer. La seule certitude que nous avons, c’est que l’inertie et l’aveuglement idéologique auraient des conséquences plus lourdes encore.
Quelques amis de Prométhée
mai 2010