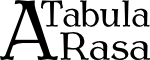Un Gérard
Limites du mouvementisme
Les assemblées dans le bordel anti-CPE de 2006 à Paris
On entend parfois les vieux militants autonomes conter nostalgiques la gloire des « mouvements » passés. Sans remonter plus loin, il y a eu des époques fastes comme la fin des années 90 (CIP en 1994, grèves de décembre 1995, mouvement des sans-papiers de 1996-97, mouvement des chômeurs fin 1997-début 1998) puis le creux pratiquement jusqu’à la mobilisation lycéenne de 2005, suivie des émeutes de novembre et du mouvement anti-CPE cette année (passons sur les journées syndicales contre la réforme des retraites de 2003). Entre temps, des modes permettent de continuer à s’agiter : expulsions, squats, prisons, nouvelles technologies (OGM, biométrie, à présent les nanos) sont par exemple les sujets de contestation, dans l’ordre ou le désordre, mêlés ou pas. De « mouvement » en « mouvement», de lutte thématique souvent chargée de racket émotionnel (urgence, rapports personnels, impuissance face au monstre) en lutte-parcellaire-faute-de-mieux, le militant pourrait ainsi presque aller jusqu’à la retraite, satisfait du devoir accompli.
Et pourtant, quelque chose ne tourne pas rond ces derniers temps sur la planète mouvementiste : beaucoup ont suivi les feux de la révolte de novembre 2005 en spectateurs, avant de constater qu’ils étaient bien démunis quant à leur contribution possible. Puis, lorsque le mouvement anti-CPE a impliqué bien plus que les étudiants, avec l’entrée en scène des lycéens et d’une frange plus ou moins nombreuse et organisée (selon les villes) d’individus énervés venus simplement en découdre ou foutre la zone, nombre de militants ont tenté d’appliquer leurs recettes traditionnelles (assemblée, tracts, occupation, cortège, appels) (1), mais avec bien peu de succès.
Ce qui leur donnait habituellement une raison d’agir, radicaliser le mouvement, mettre à l’épreuve leurs modes d’organisation et leurs mots d’ordre, se divertir certainement, engranger des forces pour la suite aussi, a semblé souvent dépassé par le mouvement réel.
Et pourtant, à l’heure où les feux de novembre se diffusaient des périphéries de Paris aux centres urbains de Lille ou Toulouse, des métropoles aux petites villes, des voitures aux commissariats, transports en commun, écoles, postes et entrepôts, les idées d’intervention près de chez soi pour participer à la fête en cours ne devaient pas manquer. Mais encore faudrait-il ne pas réserver le monopole de ces révoltes à une catégorie sociale fantasmée, forcément extérieure à soi, ni à un seul mode d’action, forcément de masse ou de communauté de non-vie. Les petits groupes mobiles ne sont inaccessibles qu’à la personne atomisée, pas à l’individu et ses compagnons. Le feu et ses cibles ne sont pas encore brevetés, ni exclusifs des autres armes classiques de la subversion (du sabotage à l’affiche, du détournement à l’agitation sur la voie publique). De même, à l’heure où le rapport de force contre le CPE se jouait essentiellement dans la rue, où la spontanéité présidait les manifs sauvages, où les différents blocages de l’économie n’étaient pas uniquement conditionnés par le nombre, où la prise de la rue offrait souvent des possibilités inédites, mettre l’accent sur des assemblées/occupations (assemblées étudiantes puis EHESS et suivants) a caricaturalement montré les limites des formes d’auto-organisation classiques de la frange « mouvementiste».
L’assemblée (souvent couplée à une occupation) peut en effet être aussi bien un outil supplémentaire que se donnent des individus qui s’associent dans la lutte en vue d’une pratique commune ou coordonnée, voire pour se rencontrer avant de continuer à s’éprouver dans l’action, ou à l’inverse n’être qu’une forme passe-partout de laquelle devraient surgir miraculeusement tout à la fois les affinités à partir de la simple accumulation d’individus, l’organisation des tâches à accomplir dans le mouvement (en plus du temps et de l’énergie investis dans l’occupation elle-même), voire même un discours commun, souvent a minima puisque produit par consensus.
On a ainsi pu assister parfois à ce renversement qui a fait d’une assemblée non plus un moment de confrontation/coordination de praxis, mais un organisme décisionnel : si une minorité décidée avait pu seule bloquer une université, c’est pourtant l’assemblée qui par la suite décidait au nom d’une quelconque souveraineté de laisser travailler l’administration ou de débloquer les lieux (temporairement ou définitivement), décision qu’on ne pouvait légitimement bafouer sous peine de fascisme aggravé. On a aussi pu assister à d’autres assemblées, dont l’unique objectif semblait être leur propre existence et leur répétition sans fin, dès lors qu’elles étaient réduites de fait à de simples échanges de points de vue déconnectés de toute volonté de pratiques.
La caricature parisienne de la forme « assemblée » a surtout été ces assemblées étudiantes ouvertes à tous... les étudiants non-bloqueurs, bureaucrates ou désireux de continuer leur train train, en présence des vigiles ou tolérées là où la présidence le voulait et à ses conditions (horaires, choix des salles/amphis pour des « questions de sécurité», non-fumeurs,...). L’assemblée y a jusqu’au bout été une fin en soi, une auto-mise en scène blasée de la légitimité, de la respectabilité citoyenne (votes, tours de parole, ordres du jour, comptes-rendus, bureau) qui occupait l’essentiel de son temps, déléguant à d’obscures commissions enjeux des luttes de pouvoir l’organisation des fameuses « actions » (les blocages ou prises de rue sauvages et statiques) auxquelles tout bon étudiant anti-CPE se devait de participer en en sachant bien peu.
C’étaient incarnées et exprimées là toute la pratique démocrate de la soumission à la dictature du nombre, du respect et de la fausse égalité des deux côtés de la barricade (bloqueurs et anti-bloqueurs, casseurs potentiels et services d’ordre syndicaux), et toute la mise en application du dispositif citoyen d’une société civile forcément imaginaire (sans classes, sans désirs négatifs de destruction et d’utopies révolutionnaires) qui tirerait d’une légitimité en construction —donc fragile, à préserver et élargir— son droit à exiger d’un gouvernement moins légitime le retrait du CPE. Il n’est dès lors pas surprenant que les militants des différentes chapelles du gauchisme et du syndicalisme, même rouge et noir, n’aient pu y tenter que d’étendre généralement en vain la liste des revendications, ou de se créer une base par un activisme démonstratif, rejouant aux ingénus le coup de l’opposition entre « démocratie directe » et « fausse démocratie » : derrière ce mauvais jeu de mot se cache en effet toute leur ambiguïté de bureaucrates, aspirants gestionnaires de quelque chose, du moment que ça vient de la masse, d’en bas plus ou moins à gauche.
Les brèves assemblées de l’EHESS occupée (du 20 au 24 mars) ont représenté l’autre caricature de cette forme « assemblée » comme fin en soi, cette fois non plus comme mini-parlement singeant celui de la domination, mais comme instrument creux et fétichisé, volonté d’auto-organiser ex-nihilo ce qui ne pouvait (et ne voulait ?) l’être.
L’assemblée comme outil de la guerre sociale prenait généralement corps et intérêt lorsque des individus auto-organisés en ressentaient la nécessité, en vue de se coordonner, d’échanger leurs expériences concrètes, de confronter leur praxis. C’était dans ce cas un outil qui se rajoutait aux autres, et notamment à tout le jeu des rapports informels tissés avant puis autour de l’assemblée. Cette force supplémentaire, dans une perspective anti-autoritaire, ne constituait de plus pas un agrégat supérieur aux groupes affinitaires, en ne s’exprimant pas en son nom, en n’ayant aucune possibilité de décision et en n’ayant pas pour objectif le nombre.
Il aurait pu en être ainsi de l’assemblée de l’EHESS, si des contenus s’étaient auparavant dégagés dans ce mouvement, permettant de se confronter sur des pratiques déjà existantes (ou des volontés de) et sur des bases théoriques communes au sein de la partie non-étudiante du mouvement. Mais ce n’était pas le cas, et cette assemblée/occupation n’a plus eu qu’à devenir une vaste foire où chacun venait vendre sa soupe. Esquisse de quelques possibles non advenus :
Plutôt que de radicaliser d’abord le « CPE non, on veut un vrai CDI » en « ni CPE, ni CDI», ces bases communes auraient pu ainsi être de développer une critique frontale du travail (du type « on veut pas bosser du tout»), couplée à d’autres modes de réappropriation que la dépouille. La dernière assemblée de l’EHESS s’est par exemple déroulée au soir des affrontements d’Invalides, justement parsemés de quelques dépouilles parfois sauvages. Or il y a plus été question de stigmatiser ces formes assez grégaires et dérisoires, en créant un espèce de sujet collectif négatif qui en serait l’auteur, que d’y opposer des réappropriations qui seraient « nôtres», conservant la bonne idée de profiter de ces moments de rupture de la normalité pour développer d’autres perspectives. Pour mémoire, il y avait par exemple eu plusieurs autoréductions de supermarchés pendant le mouvement des chômeurs, et même un essai de pillage en règle d’un Cash Converters à Bastille. Ce fut aussi le cas cette fois-ci à Toulouse par exemple.
De même, plutôt que d’avaliser le « bloquons l’économie » avec son corps nu lorsqu’il était déjà dans l’air et que nous y participions (occupation des gares par exemple), un contenu commun aurait pu être de développer une critique du capitalisme et d’un de ses points faibles qui est la circulation des marchandises, en la couplant à d’autres formes d’attaques (comme le sabotage ou la destruction, et visant plus large que la seule circulation routière/ferroviaire).
Enfin, si différents groupes affinitaires et informels avaient ressenti le besoin de se coordonner afin de dépasser des limites vécues les jours précédents, c’est un tout autre projet de faire émerger un moment organisationnel à partir de ce besoin commun, que de créer une assemblée ouverte aux vagues « gens en lutte » nommés « hétérogénéité » en vue de « s’agencer et s’organiser». On peut citer de mémoire quelques questions qui revenaient alors au cours de discussions informelles, et auraient pu constituer un autre point de départ : comment sortir du spectacle rituel des frites type Sorbonne au profit par exemple de balades sauvages ravageuses au cours ou à la fin de manif (comme à Nation le 18 mars), quelles initiatives développer pour ne pas attendre les manifs des mardis et jeudis, comment développer une mobilité géographique qui dépasse le cadre étroit de Paris et s’y mêler à un antagoniste plus ouvert (d’autant que certains compagnons vivent en périphérie).
Ces quelques points ne sont pas posés là pour refaire l’histoire. Si ces tendances et possibles esquissés n’ont pu se dégager comme bases d’une assemblée, c’est pour souligner que les limites de l’assemblée d’occupation de l’EHESS ont finalement été celles de ses initiateurs à la perspective mouvementiste, qui y entérinaient logiquement les limites du mouvement lui-même. Car à défaut de contenu autonome au sein de ce dernier (voire en dehors : n’étant pas étudiants pour la plupart, et se foutant du CPE comme beaucoup) et de désirs d’expériences nouvelles à partager dans l’espace public, l’assemblée de l’EHESS ne pouvait qu’être cette coquille vide où des individus cohabitent sans n’avoir rien d’autre à faire ensemble qu’à mimer un semblant de radicalisme verbal collectif ou à se juxtaposer dans un grand squat. A l’heure où se dégageaient des ruptures de la normalité toujours plus prometteuses, mais où la seule communauté de lutte de la partie non-étudiante ne se trouvait que dans les affrontements et les blocages de rue, une assemblée se donnant pour objectifs « d’inventer des formes de luttes adaptées à la situation » en s’adressant justement à l’hétérogénéité ne pouvait que se heurter à ses propres limites : l’absence de perspectives et les moyens de les mettre en œuvre.
S’il est une force de l’individu, au sein de cette société qui présente la double caractéristique d’atomiser et de massifier à la fois (les personnes sont toujours plus séparées les unes des autres et vivent en même temps toujours plus des vies identiquement normalisées), c’est sa capacité à développer une autonomie basée sur ses propres désirs et affinités. La capacité à partager ces désirs avec d’autres individus, liée à une connaissance et une confiance réciproques, peut, avec un minimum de volonté partagée, créer et mettre en œuvre des projets offensifs. Et lorsqu’un mécontentement gronde, qu’un mouvement social éclate, ces groupes affinitaires peuvent décider d‘y participer, sur leurs propres bases et objectifs.
Les affrontements liés à la foule, au sentiment collectif éphémère de puissance, notamment au début devant la Sorbonne et aux alentours ou plus tard lors de la balade de Bastille à Montmartre, nous ont enthousiasmés et lancés dans la bataille, pour ceux qui étaient encore réticents à ce mouvement longtemps spécifiquement étudiant. La répétition de ces affrontements, toujours plus spectaculaires et verrouillés, plaidait cependant selon nous assez rapidement pour non seulement multiplier les possibilités de mener avec plus d’agilité nos activités antagoniques existantes avant le mouvement, mais aussi pour amplifier autrement la rupture de la normalité, indispensable base pour apprendre de nouvelles manières d’être ensemble et de lutter, d’entrevoir un monde totalement différent et de construire les bases des révoltes futures.
Or ce double mouvement —augmenter nos possibilités habituelles, perturber aussi autrement la normalité— n’est justement effectif qu’en conservant notre autonomie au sein du mouvement, s’en s’y diluer. Le problème posé par le mouvementisme, par ceux qui veulent radicaliser le mouvement en s’y organisant ou simplement être là où ça speede le plus, est que notre rapport n’est plus dialectique, fonction de notre analyse de ce qui se passe et de nos perspectives, mais que nous nous lions à la masse, avec ses forces (comme certains affrontements ouverts ou balades de plusieurs heures) et ses faiblesses (comme sa capacité à être menée dans des pièges à flics ou à se retourner contre nos pratiques).
Un tract distribué lors de la reprise à Jussieu rappelait ingénument que cette fac de sciences est comme les autres blindée de labos de recherche, tandis que d’autres nous ont fait remarquer que le toit de l’EHESS abrite une gigantesque antenne de téléphonie mobile qui a fait l’objet d’une tentative de sabotage, ou que des profs de cette école pleuraient sur les recherches perdues avec leurs disques durs. Ces simples cas de nuisances auxquelles la main avait plus aisément accès au cours de ce mouvement offrent un banal exemple de comment une perspective révolutionnaire peut développer à la fois son autonomie dans un mouvement, et tenter de dépasser ses limites (le énième contrat précaire, le rituel d’affrontements toujours mieux gérés par la police) en reliant ce qui est généralement séparé, ici une critique pratique de la techno-science par le sabotage ou le vol, à l’intérieur d’un mouvement concentré sur la précarité et pratiquant surtout des occupations de l’espace urbain.
Ce qui fut généralement intéressant dans les mouvements sociaux de ces dernières décennies a rarement été leurs intentions (défensives), mais bien plutôt la perturbation de la normalité du quotidien qu’ils ont engendrée. Nous pouvons alors choisir de répéter à l’infini des pratiques qui s’insèrent dans leurs limites initiales, en essayant de les radicaliser et en se contentant de suivre l’odeur des gaz lacrymogènes portés par d’autres, ou bien au contraire sortir enfin de cette logique pour affirmer notre propre praxis en dialectique avec ces mouvements, ce qui signifie d’un côté élargir et intensifier collectivement cette perturbation sur nos bases, et d’un autre affirmer individuellement nos désirs, rages et attaques en profitant de son existence.
1. Nous parlons ici à partir de l’expérience parisienne, certes un peu particulière par le nombre d’agités et la diversité des possibilités.
PS : on pourra lire une chronologie du dit mouvement anti-CPE dans le même numéro de Cette Semaine ici