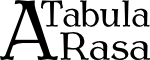Sur le banc des accusés
« Cependant les boutiquiers de Paris,
en faisant leur étalage, l’autre matin,
se sont dits avec leur robuste bon sens :
— Il n’y a pas la moindre erreur, on veut saper
les assises de nos monuments séculaires,
nous sommes en face d’un nouveau complot.
Allons, allons, braves boutiquiers !
vous errez aux plaines de l’absurde.
Songez un peu que la conspiration dont
vous parlez n’est pas nouvelle ;
s’il s’agit de jeter bas les édifices vermoulus
de la société que nous haïssons,
il y a longtemps que cela se prépare.
…
C’est notre complot de toujours. »
Zo D’Axa, 1892
Comment ça, la répression ?
Nous vivons dans un monde où toute structure de la société, tout mécanisme, tout rapport social a aussi une fonction répressive. On n’aurait guère de problèmes à démontrer que les forces strictement répressives (la police, l’armée, la Justice et ses prisons) ne sont en effet qu’une petite colline face à la montagne de l’ensemble de la société oppressante. Si l’on définit la répression comme le mouvement qui nous empêche, nous décourage et nous punit de faire des choses qui risquent d’ébranler l’ordre économique, social et moral, il est facile de percevoir comment toutes les institutions démocratiques empêchent l’auto-organisation sociale, comment l’idéal d’un amour en camisole décourage des liens affectifs sans brides et comment l’économie punit toute tentative de bannir l’argent hors de sa vie. Ainsi, la répression ne saurait être réduite au seul bras armé de la domination, même au moment où celui-ci frappe à la porte des subversifs.
Lorsque ce « bras armé » toque à la porte de compagnons avec son arsenal judiciaire, carcéral et policier, l’Etat ne tente pas uniquement de freiner la diffusion d’idées et de pratiques subversives ou d’essayer de mettre « hors circulation » quelques éléments encombrants. Il cherche aussi à nous amener sur le terrain stérile de l’affrontement entre les forces répressives strictes et le courant subversif, un affrontement certes inévitable, mais qui risque souvent de nous bloquer sur un seul obstacle (la répression des compagnons), nous empêchant ainsi de continuer à courir « dans toutes les directions ». Affronter la répression spécifique contre des compagnons sur le terrain qu’elle-même pose, revient alors à creuser sa propre tombe.
D’ailleurs, en quoi la répression qui nous touche serait-elle détachée de la répression qui touche la société en général ? On pourrait dire que tout un chacun ne trouve certes pas des caméras cachées chez lui, mais cela ne saurait nous faire oublier que la vidéosurveillance est désormais partout. On pourrait dire que tout un chacun n’a certes pas à se défendre contre des accusations d’association terroriste ou autre, mais n’en est-il pas moins vrai que de larges couches sociales se font condamner à la chaîne, soit devant un juge, soit par les instances de l’ordre social, moral et économique, parce que le fait de chercher à vivre, voire d’exister, donne déjà lieu à une répression permanente ? Il n’est pas difficile de prévoir que dans le monde actuel, toujours plus instable et où les tensions sociales sont toujours moins gérables qu’elles n’ont pu l’être dans le passé récent, la répression ira croissant. La construction de toutes sortes de nouvelles prisons n’est qu’un signe manifeste de toute une tendance qui a le vent en poupe.
La dangerosité sociale
Mais hasardons-nous maintenant sur le terrain de la répression spécifique contre des luttes autonomes et des individus qui se battent pour la liberté. Parfois, les arrestations de compagnons, la répression d’une lutte, la diffusion de menaces à peine dissimulées contre ceux qui ne sont pas prêts à enterrer la hache de guerre, amènerait à croire que nous serions dangereux. Dangereux pour l’ordre établi, comme est classé l’anarchisme depuis quelques années en Belgique, considéré comme « la menace la plus importante et la plus diffuse pour la sûreté du pays », sur la bonne voie car objet d’une répression ? De telles croyances proviennent tout simplement d’un manque de conviction dans ses propres idées, d’une carence de perspectives, car elles s’amusent à reprendre à leur propre compte les paroles de la domination. A l’inverse, il n’est malheureusement pas rare de constater que, dans le courant subversif même, des bruits courent sur certains lieux, certains compagnons, certains terrains de lutte qui seraient dangereux, qu’il faudrait mieux éviter, parce qu’ils attirent la répression et autres conneries de la sorte. Dans les deux cas, la même « échelle de mesure » est utilisée : celle de la morale dominante et des lois en vigueur. Ou pire encore, une échelle « militaire », qui voit la subversion comme la somme d’attaques attribuables à tel courant ou à telle tendance ; échelle malheureusement trop fréquente, chez les légalistes et réformistes, comme chez les « subversifs » autoritaires. Que disait déjà cette citation ? : « On voit les lucioles parce qu’elles volent la nuit. Les anarchistes font de la lumière aux yeux de la répression, parce que la société est grise comme la pacification. Le problème, ce n’est pas la luciole, mais bien la nuit. »
Le danger et la dangerosité sont bien ailleurs. C’est la menace souterraine qui traverse les siècles et tous les visages que la domination a pu prendre : la menace d’une explosion sociale, de la subversion de l’existant. Inutile, et aussi pernicieux pour sa propre dignité, de cacher que les activités et les idées des subversifs antiautoritaires ciblent à encourager, faire éclater, défendre, répandre la subversion et donc la nécessaire insurrection, forcément violente et négatrice des lois et des morales. Et l’Etat cherche à réprimer, persécuter, étoufferce qui le met en danger. La menace n’est donc pas une centaine d’anarchistes, mais la diffusion toujours possible et imprévisible d’idées et de pratiques subversives que nous portons. La menace, la dangerosité, c’est la contagion qui se met à l’œuvre ou qui, du moins, reste toujours possible. D’où l’évidence que la meilleure solidarité, consiste à continuer à diffuser des idées et des pratiques subversives, au-delà de toute échéance judiciaire ou étatique. Et aussi que la meilleure défense contre la répression n’est pas de constituer une quelconque puissance imaginaire qui y ferait face (dans la logique de l’affrontement symétrique, imprégnée d’une vision militariste et hiérarchique de la subversion), qu’il ne s’agit pas simplement (ou mieux, pas tant) de s’approprier des techniques et des savoir-faire pour la contourner, mais bien de perspectives de lutte, d’idées approfondies, de la recherche sociale de complicité dans le refus et dans l’attaque de ce monde. En fait, on pourrait extrapoler cette question afin de mieux la saisir : une insurrection (dans le sens anarchiste, c’est-à-dire, comme phénomène social) peut-elle être vaincue de manière militaire par les forces répressives ? La « réussite » d’une insurrection dépend-elle du nombre d’armes et de « troupes » à notre disposition ? Ou les raisons des « défaites » des insurrections ne sont-elles pas plutôt à chercher dans le manque de perspectives antiautoritaires, de « fermeté » dans le refus de toute sorte de chef ou encore, dans la peur de l’inconnu de la liberté ? La répression des insurrections, tout comme leur explosion ; la répression des insurgés, tout comme la contamination du tissu social par leurs idées et pratiques, n’est jamais qu’un fait militaire, mais avant tout social. Et de nombreuses conséquences découlent d’une vision antiautoritaire de cette question, qui est au fond essentiellement celle de la transformation révolutionnaire de l’existant.
Sur le banc des accusés…
De nombreuses personnes conçoivent la Justice (les lois, les tribunaux, les procès) exclusivement comme une institution, c’est-à-dire, un bastion du pouvoir dans le marécage social. Néanmoins, toutes les institutions se fondent à part égale, voire prépondérante, sur le consentement social. Elles sont des expressions des rapports sociaux existants, mieux, ce sont des rapports sociaux. C’est-à-dire que l’Etat, d’un point de vue subversif, n’est pas quelque chose d’extérieur au tissu social, il en fait partie comme il le structure à son tour. Prendre possession de l’Etat signifie alors vouloir perpétuer les rapports sociaux qui le fondent et en découlent ; le détruire, c’est chercher une autre base, un autre fondement (la liberté) pour les rapports sociaux. L’argent, comme institution, ne peut exister que parce que la société entière lui octroie de la valeur ; et réciproquement, l’argent conditionne les rapports entre les gens. Une redistribution plus équitable de l’argent ne changerait au fond rien aux rapports que son existence génère, le brûler signifie entamer la construction d’un monde où l’économie ne détermine plus les rapports entre les gens, mieux, où la logique économique (commerce, travail, accumulation, productivisme) est repoussée. La pénétration de la marchandise dans toutes les sphères de la vie donne d’ailleurs un autre bon exemple de la coïncidence entre les structures répressives et les rapports sociaux tels qu’ils existent aujourd’hui.
Cette prémisse posée, asseyons-nous un instant sur le banc des accusés. Comment pourrait-on soutenir que dans le tribunal rien n’a d’importance (en ce qui concerne notre attitude), sans en même temps ouvrir les portes pour affirmer que rien n’a d’importance dans n’importe quelle structure de la société ? Si le tribunal, comme l’usine, la maison communale ou le foyer familial, sont des structures répressives dans le tissu social, il devient intenable de prétendre que notre attitude, notre activité et nos idées n’y ont aucune importance. Dire devant un juge qu’on regrette de lutter pour la liberté ne diffère fondamentalement pas de dire à un homme qui nous maltraite qu’on l’aime – à moins que l’on croît que la subversion est une question de posture, de camouflage, de postiche, de sournoiserie. Renoncer à ses idées au nom de la tactique et de la stratégie (au-delà du fait de ne pas toujours crier sur tous les toits qui on est et ce qu’on pense pour des raisons de « discrétion » que peuvent requérir certaines activités, comme par exemple la réalisation d’un sabotage, une vie dans la clandestinité), dans un tribunal comme dans la rue, équivaut à leur ôter toute potentialité subversive, à les désamorcer – exactement ce que la répression cherche à obtenir. Ceci dit, il n’existe pas de recettes ni d’axiomes à appliquer ou à respecter dans la confrontation avec le tribunal, il n’y a que la cohérence entre ce qu’on pense et comment on se comporte, ce qu’on désire et comment on lutte. Cette cohérence ne peut être totale que dans le sens où notre individualité est une exigence totale, autrement dit, c’est une tension permanente qui palpite au rythme de notre vie même. Tout le reste, n’est que le rebut de la politique.1
Affirmer que nous ne reconnaissons ni « culpabilité » ni « innocence », que nous refusons tout juge, tout tribunal, car nous sommes ennemis de toute loi et donc pour toute transgression qu’inspire notre désir de liberté, n’est donc en rien un jeu tactique, mais justement une expression de cette tension vers la cohérence. La solidarité cesse ainsi d’être un simple réflexe antirépressif pour devenir la possibilité d’une complicité, dans le sens où nous sommes tous et toutes « coupables » de nos idées et des pratiques qui en découlent.
L’ami de mon ennemi ne peut jamais être mon ami
A force de considérer la Justice non pas comme un rapport social comme tous les autres rapports sociaux, on finit par assister aux plus sales jeux tactiques. Inutile de souligner que dans la plupart des procès, rares sont ceux qui cherchent à ne pas rentrer dans la logique de la Justice, qui refusent d’enterrer leur dignité devant le juge, qui ne balanceront d’aucune manière (dans de nombreux cas, cela revient aussi à refuser de dire si on a oui ou non commis un tel méfait). Malheureusement, il n’est pas rare qu’il en aille de même pour les ennemis déclarés de l’ordre établi quand ils se trouvent devant un tribunal. Là, il n’est pas rare que l’opportunisme et la politique font leur rentrée sur scène. On voit alors que la cohérence de refuser de s’allier et de passer des accords avec des forces politiques philo-institutionnelles ou autoritaires, est « provisoirement » mise au rebut au nom de la pression sur le juge, du besoin d’une solidarité large et diverse, du chantage moral de vouloir faire sortir les compagnons à tout prix (mais, en étant un peu méchant, on pourrait dire, sans pour autant risquer soi-même sa liberté). Tout d’un coup, les ardentes critiques des « droits » et des « devoirs » s’échangent contre des alliances indigestes avec quelque ligue des droits de l’homme ; la négation de l’économie et de l’argent est mise de côté pour profiter du soutien d’un syndicat, gestionnaire de la conflictualité sociale et des forces de travail ; le refus du spectacle et de la représentation se transforme en accueil d’un journaliste « qui fera pression » ou en acceptant les rôles existants (chacun à sa place et tous ensemble dénoncer démocratiquement les abus) par exemple en publiant une « lettre ouverte » dans un quotidien de la presse officielle. Que dire ? L’autorité ne saurait être combattue avec des moyens autoritaires, voilà une affirmation simple qui reste d’actualité.
Par une telle recherche d’alliances, on ne violente pas seulement ses propres idées et les parcours de lutte qui se sont dessinés et qui se dessineront encore, on n’hypothèque pas seulement les possibilités de rencontre et de complicité au niveau social (les exploités sont bel et bien aussi habitués à l’hypocrisie, mais celle-ci ne constitue pas un sol fertile pour la rencontre et pour une lutte commune entre individus rebelles). On se place en outre irrévocablement sur ce terrain qui est à la liberté et à la vie ce que le pétrole est à la mer : la politique. S’engager dans la politique avec ses alliances nauséabondes, ses délégations, son agir « en se bouchant le nez », sa modération vers le « moins pire », son opportunisme écœurant, est aux antipodes des terrains où la subversion devrait être portée : dans la rue, parmi les exclus, les exploités et les rebelles, afin de répandre des idées émancipatrices, d’encourager la révolte, d’envisager des attaques toujours plus acérées contre l’ordre social. Combien il est inintéressant de perdre son temps et son énergie dans des discussions avec des requins politiques, des imposteurs autoritaires, des moutons suiveurs d’idéologies, des légalistes avec leurs bouches pleines de cadavres ; à quel point est préférable l’aventure de porter la subversion au cœur des situations sociales explosives, loin de toute médiation et représentation. La première perspective se termine inévitablement par des rassemblements, confus au niveau du contenu et en général démoralisateurs, devant le tribunal ; la deuxième part à la recherche de transformer un épisode de répression spécifique de compagnons et de luttes en énième mèche pour allumer la poudrière sociale.
Tôt ou tard
Inutile de faire l’autruche : tôt ou tard, tout individu révolté et toute lutte autonome se heurtera à la répression, que ce soit en encaissant des coups ou en reculant devant la menace de ceux-ci. Dès lors, il est certes important à garder la répression (dans le sens le plus large possible) présente à l’esprit, en discutant et en approfondissant idées et perspectives, voire de s’y préparer techniquement, mais toujours en la reliant avec l’ensemble des rapports sociaux et des tensions et conflits en leur sein. Aucun doute non plus sur la nécessité d’organiser le soutien matériel aux compagnons arrêtés ou incarcérés, sans que pour autant celle-ci dépasse le cadre de simple question technique.
Comprendre et continuer à considérer la répression simplement comme un obstacle, et non comme un mur infranchissable (et encore moins le plus important), n’est certes pas tâche facile. Et nous ne parlons pas uniquement des possibles années de taule, mais aussi tout ce qui a trait à la répression « préventive », la surveillance et les poursuites au sens large du terme. Aujourd’hui déjà et probablement demain encore plus, nous devrons faire appel à notre créativité et notre imagination pour briser l’étau répressif, mais ceci n’est, comme nous le disions auparavant, que dans une moindre mesure une question technique et de capacités : c’est surtout une question de perspectives, d’idées et de projectualités mises à l’épreuve, forgées dans la bataille au quotidien.
Pour finir, n’oublions jamais qu’en fin de compte, nos idées, nos méthodes et nos désirs demeurent à jamais incompréhensibles pour les chiens de garde de l’Etat, car ils ne saisiront jamais que des individus puissent s’organiser et s’associer librement et de manière antiautoritaire ; ils ne comprennent pas que tout être humain a la capacité et le choix, à tout moment, de se révolter, et que c’est d’ailleurs à cette capacité et à cette possibilité de choisir que les révolutionnaires devraient faire appel. Le marécage de la conflictualité sociale n’est donc pas une affaire militaire, technique et tactique, mais profondément et intrinsèquement sociale. Etendre ce marécage, ce qui revient à l’auto-organisation sociale du refus et de l’attaque de l’ordre social et de l’autorité, faire en sorte qu’elle puisse s’armer avec conscience et idées, est la meilleure façon de contrecarrer, voire de dépasser, la répression.
Et de toute façon… il n’y a rien à lâcher, c’est ma vie même que j’ai choisi de mettre en jeu ; mon jeu.
Publié dans Salto, subversion & anarchie, n° 2, Bruxelles, novembre 2012
1Il ne s’agit ici pas des éventuels aspects « techniques » d’un procès, mais de l’attitude la plus fondamentale ou de l’éthique (le contenu) qui est à la base de tout un éventail d’expressions plus « concrètes » (les formes). Le contenu pointe le refus de se distancier de nos idées et pratiques subversives, ce qui peut se traduire devant un tribunal dans de nombreuses formes, allant du refus total (en refusant de se présenter devant le tribunal), en passant par se soustraire à la justice (en passant dans la clandestinité), par refuser de répondre à aucune question ou requête, jusqu’à « revendiquer » ses idées devant un juge (et aussi, de fait, dans la rue, dans le rapport social qui est à la base de la Justice, ce qui ne revient pas à se déclarer coupable de telle ou telle accusation). Enfin, il y a encore tout l’aspect strictement technique de la défense juridique (nécessairement selon la logique de la Justice même) qu’on peut laisser à un avocat, ou pas. Mais là non plus, nous ne pensons pas que « tout se vaut ». Pour commencer, il faut prendre en compte le refus selon nous fondamental, de prouver sa propre innocence en pointant d’autres (connus ou inconnus) comme les coupables. On peut aussi noter la différence fine, mais également fondamentale entre un avocat qui demande l’acquittement et un avocat qui répond à la question de la culpabilité (ou de l’innocence). Citer, comme c’est couramment le cas lors des procès, du « statut social » afin d’obtenir de la part du juge une certaine clémence, est clairement néfaste pour sa propre intégrité. Finalement, la tension éthique et subversive n’est pas la seule chose qui joue, il y a évidemment aussi les circonstances particulières, la nature des accusations et, ce qui pas la moindre des choses, les inclinaisons et préférences individuelles.